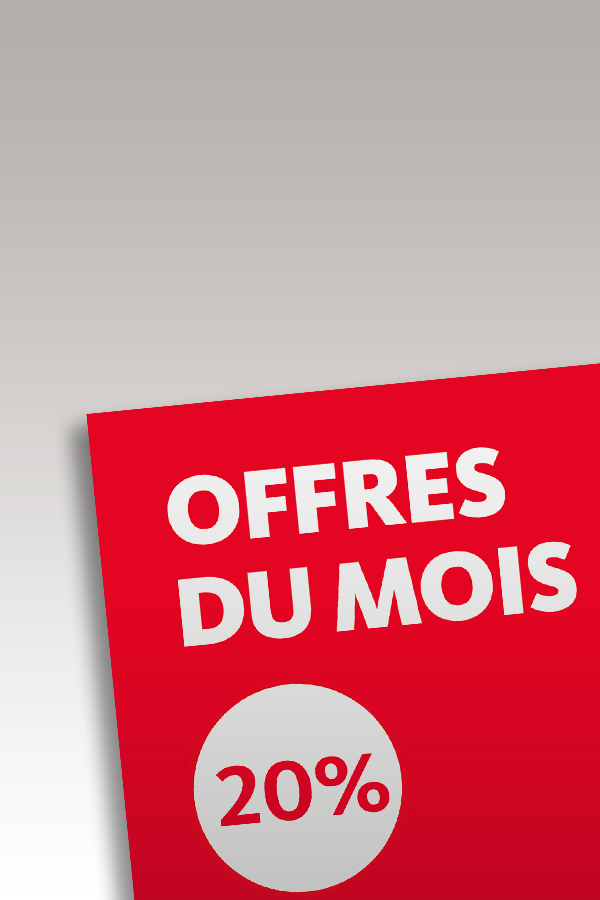Le système endocrinien se compose d’une dizaine de glandes et d’organes, qui à travers les hormones qu’ils sécrètent, régulent les fonctions essentielles du corps. Bien que petit en volume (quelques grammes de tissu au total), il a un impact majeur sur l’organisme et ce, tout au long de la vie. À partir de la cinquantaine, les taux hormonaux varient. S’ensuivent, chez les deux sexes, des symptômes plus ou moins marqués. Ce dossier fait le point sur cette période parfois difficile à vivre.
Ménopause et Covid, une liaison dangereuse… ou pas
Entre observations troublantes et hypothèses plus ou moins solides, qu’en est-il, bientôt six ans après le début de la pandémie, des soupçons d’interférences entre maladie à coronavirus et ménopause?
Des faits, rien que des faits
La ménopause est une phase naturelle de la vie des femmes, pas une maladie. Elle se manifeste néanmoins par un certain nombre de symptômes liés à l’arrêt progressif de la production d’œstrogènes. En résultent des troubles de l’humeur, des bouffées de chaleur, des sueurs, de la sécheresse des muqueuses, des perturbations du sommeil, pour ne citer que les plus courants.
Quant aux dommages provoqués par le Covid, ils se concentrent sur les voies respiratoires et la sphère ORL, les typiques pertes de goût et d’odorat, et parfois des atteintes gastro-intestinales ou cutanées. Difficile donc de trouver des similitudes entre les symptômes de la ménopause et du Covid. Sauf si l’on tourne le regard du côté du «Covid long», un syndrome qui persiste des semaines, voire des mois après la phase aiguë, et qui touche environ 3,5% de la population. Or on constate que la majorité des victimes de Covid long sont des femmes, que la moyenne d’âge se situe entre 45 et 50 ans, et que, en plus des symptômes classiques ci- tés plus haut, des troubles qui s’apparentent à ceux de la pré-ménopause sont fréquemment cités, comme des douleurs articulaires, une sensation d’épuisement, ou de l’anxiété. Alors pour interpréter les analogies manifestes entre Covid long et pré-ménopause, essayons de comprendre comment ces deux états en apparence si différents pourraient s’influencer l’un l’autre.
Du rôle des hormones féminines sur le Covid
C’est un fait : les œstrogènes améliorent la qualité et l’intensité de la réponse immunitaire. Un avantage qui explique, en partie, pourquoi les femmes ont été moins touchées par les formes sévères d’infections à SARS-Cov-2 pendant la pandémie. Mais cet avantage peut se transformer en inconvénient si le système immunitaire reste mobilisé plus longtemps que nécessaire. Des réactions inopportunes, de type inflammation chronique ou autre, sont susceptibles d’apparaître dans tout l’organisme et perdurer, comme cela se passe dans le cas du Covid long. Ce n’est pas un hasard si les maladies auto-immunes (sclérose en plaque, lupus, polyarthrite rhumatoïde, etc.) affectent quatre fois plus de femmes que d’hommes ! En très résumé, les hormones féminines participent à réduire la gravité, mais à prolonger la durée.
Du rôle du Covid sur les hormones féminines
Environ une femme sur six dit avoir observé un cycle menstruel plus long, plus abondant ou plus douloureux après avoir eu le Covid, sans que l’on sache si c’est le virus qui est en cause, ou le stress occasionné par la situation. En ce qui concerne la fertilité, il n’a pas été démontré d’impact suite à une infection à coronavirus, même si en théorie, le système reproducteur féminin est conçu pour éviter de tomber enceinte pendant une infection. Quant aux témoignages de ménopauses précoces provoquées par le Covid, ils existent et sont pris au sérieux. Mais à ce jour, aucun lien de causalité n’a pas pu être établi par la science. Les spécialistes considèrent en outre que la probabilité qu’une ménopause précoce soit déclenchée par une infection, quelle qu’elle soit, est extrême- ment faible. A noter toutefois que l’origine de plus de la moitié des ménopauses précoces reste inexpliquée…
Et le vaccin là-dedans ?
Comme tous les vaccins, celui contre le Covid n’a pas échappé à son lot de rumeurs tenaces et farfelues. Et comme tous les vaccins, celui contre le Covid présente des effets secondaires indiscutables. Outre les effets indésirables classiques (sensibilité au point d’injection, fatigue, etc.), on peut mentionner des gonflements parfois importants sur le bras vacciné, des troubles menstruels, ou encore des myocardites chez de jeunes adultes. Ces effets indésirables sont rares, souvent bénins, faciles à traiter, et, inutile de le rappeler, infiniment moins dangereux qu’une «vraie» infection. En ce qui concerne la ménopause, aucune donnée significative ne permet d’imaginer une quelconque relation avec la vaccination contre le Covid, qui, rappelons-le, reste recommandée aux femmes enceintes ou souhaitant le devenir.
En conclusion
Nulle autre infection n’a été autant scrutée, analysée, commentée, étudiée, que celle à SARS-Cov-2. Et pour cause, la planète entière en a souffert, produisant une quantité exceptionnelle de statistiques, de données, d’avancées scientifiques, mais aussi de coïncidences et de théories aléatoires. En ce qui concerne l’interaction entre Covid et ménopause, rien à ce jour ne vient corroborer l’implication spécifique du coronavirus sur le déclenchement d’une ménopause. En revanche, les changements hormonaux pré- cédant la ménopause sont un facteur d’instabilité de la réponse immunitaire favorable à l’installation d’un Covid long. Ensuite, une fois la ménopause dépassée, femmes et hommes se retrouvent sur pied d’égalité par rapport aux conséquences d’une infection à coronavirus !
Mieux vivre la ménopause au quotidien
La ménopause n’est pas une maladie, elle marque la fin de la fertilité et s’accompagne parfois de troubles physiques ou émotionnels impactant la qualité de vie.
Après 45 ans, cap vers un nouvel équilibre!
Au fil des décennies, grâce aux progrès médicaux, on vit plus longtemps en meilleure santé. Selon l’Office fédéral de la statistique, l’espérance de vie à la naissance en Suisse était, en 2023, de 82,2 ans pour les hommes et 85,8 ans pour les femmes. Mais vers la moitié de sa vie, chaque individu connaîtra un bouleversement biologique majeur.
Octobre Rose : sous-vêtements et prothèses post-opératoires, parlons-en!
Une étape chirurgicale durant la prise en charge du cancer du sein est hélas sou- vent inévitable. En comparaison, la question des prothèses et des sous-vêtements adaptés peut sembler secondaire. Elle constitue pourtant un élément important du processus de reconstruction, physique et psychologique.
L’échinacée: pour renforcer son immunité au naturel
L’échinacée est une plante médicinale originaire d’Amérique du Nord, traditionnellement utilisée par les peuples autochtones pour traiter diverses infections. Aujourd’hui, elle est largement reconnue pour ses effets bénéfiques sur le système immunitaire.
La grippe : une menace qui se répète chaque année
Chaque année, avec l’arrivée de la saison froide, le virus de la grippe refait surface, provoquant fièvre, fatigue intense et complications parfois graves, notamment chez les personnes vulnérables. Très contagieuse, la grippe saisonnière touche plusieurs centaines de milliers de personnes en Suisse. Face à ce virus, la vaccination reste le moyen de prévention le plus efficace. Ce dossier vous propose de mieux comprendre le fonctionnement du virus grippal, les enjeux de la vaccination et les gestes essentiels pour s’en protéger.
Octobre Rose, tous unis contre le cancer du sein.
Depuis le temps, tout le monde ou presque a entendu parler d’Octobre Rose, la campagne mondiale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et de récolte de fonds pour la recherche. Et pourtant il reste tant à faire …
Tirez la langue pour mieux la connaitre
La bouche est une partie essentielle de notre anatomie. Et pour cause: elle est la porte d’entrée du tube digestif et des voies respiratoires. En prendre soin est donc fondamental pour éviter que des germes ne pénètrent plus profondément dans l’organisme. Elle abrite la dentition, ainsi que la langue, l’organe principal du goût, qui mérite lui aussi la plus grande attention.
La langue humaine mesure 10 centimètres en moyenne. La partie postérieure (ou pharyngienne), au plus proche de la gorge, constitue environ un tiers de sa longueur. La partie antérieure, dite orale, constitue les deux autres tiers. Cet organe possède une double innervation, motrice et sensorielle. Il sert à la mastication (ses muscles aident à positionner la nourriture ingérée entre les dents), à la déglutition et à la phonation. Il contribue également au nettoyage (superficiel) des dents.
Un tapis de milliers de papilles
La surface de la langue est recouverte de papilles gustatives, qui nous permettent de percevoir les goûts et les textures des aliments. Environ 8000 papilles gustatives sont réparties dans notre cavité buccale, non seulement sur l’ensemble de la langue, mais aussi dans le larynx et le voile du palais. On distingue quatre formes de papilles: les caliciformes, les fongiformes, les filiformes et l’organe principal du goût, qui mérite lui aussi la plus grande attention.
La langue dans tous ses états
En temps normal, la surface de la langue apparaît rosée et homogène. Mais il peut arriver qu’elle prenne une couleur et/ou un aspect inhabituel. Cela peut être le signe d’une infection ou d’un autre problème de santé. Une langue «fraise» ou «framboise», caractérisée par un gonflement de la langue et une desquamation des papilles, peut par exemple révéler une infection à streptocoques A, comme la scarlatine ou une angine bactérienne. Une langue jaune peut indiquer un problème hépatique. Elle peut également devenir blanchâtre en cas de candidose orale, plus communément appelée «muguet» – une infection causée par le champignon Candida albicans. Ce dépôt blanc s’accompagne généralement d’une mauvaise haleine. La déshydratation ou la prise de certains médicaments (antidépresseurs, antihistaminiques) peuvent égale- ment être à l’origine de cette décoloration de la langue. Si votre langue prend l’aspect d’une carte géographique, il s’agit probable- ment d’une «glossite exfoliatrice marginée» ou «glossite migratoire bénigne», qui se manifeste par l’apparition de zones roses et lisses dépourvues de papilles, délimitées par des bordures blanches et bosselées. Cette affection est bénigne mais peut entraîner une altération du goût. Enfin, le syndrome de «la langue noire velue», ainsi nommé du fait de l’allongement des papilles atteintes, qui se colorent en noir – et ressemblent ainsi à des poils – est une affection favorisée par une mauvaise hygiène buccodentaire, une alimentation essentiellement molle (donc sans effet exfoliant), le tabagisme et certains médicaments. Bien qu’impressionnante, cette affection est bénigne et se traite en corrigeant ces facteurs prédisposant.
L’aspect et la couleur de la langue sont des indicateurs de santé.
les foliées. Les filiformes, situées de part et d’autre du sillon médian, sont les plus nombreuses. Grâce à toutes ces petites protubérances, nous reconnaissons les cinq saveurs que sont le salé, le sucré, l’acide, l’amer et l’umami – ce dernier ayant été officiellement reconnu comme la cinquième saveur de base en 1985. À noter que contrairement à certaines croyances, il n’existe pas sur la langue une zone dédiée à la reconnaissance de chaque saveur. La recherche contemporaine a en effet révélé que toutes les papilles réagissent à toutes les saveurs, quel que soit leur emplacement; en revanche, leurs seuils de sensibilité diffèrent. En effet, chaque papille gustative possède 50 à 100 cellules réceptrices pour chaque saveur et chacune possède un mélange bien spécifique de ces cellules réceptrices. C’est pourquoi, chacune est plus ou moins sensible à l’une ou l’autre saveur. En dehors de ses rôles de premier plan dans l’alimentation et la parole, la langue est aussi un précieux indicateur de santé.
Prendre soin de sa langue
Pour éviter tous ces désagréments et préserver l’équilibre buccal, une bonne hygiène buccodentaire s’impose. Celle-ci repose sur un brossage minutieux des dents (au moins deux fois par jour), suivi d’un brossage doux de la langue à l’aide d’une brosse à dents à poils souples (ou d’un gratte-langue), qui permettra d’éliminer les bactéries qui s’accumulent à sa surface (et qui provoquent parfois une mauvaise haleine). Appliquez une petite quantité de dentifrice, en commençant par l’arrière de la langue et brossez doucement vers l’avant en effectuant des mouvements de va-et-vient. Pour compléter ce nettoyage, utilisez un bain de bouche mentholé pour lutter contre la mauvaise haleine et la formation de plaque dentaire. Mais attention aux bains de bouche antiseptiques! En cas d’usage prolongé, ils peuvent déséquilibrer la flore bactérienne naturelle- ment présente dans la bouche.
Il vous arrive de vous mordre accidentellement la langue au cours de la mastication? Oui, c’est très douloureux, car la langue possède de multiples terminaisons nerveuses. Néanmoins, ces lésions sont le plus souvent bénignes et guérissent d’elles-mêmes rapidement. Soyez toutefois vigilant: des morsures fréquentes au même endroit peuvent révéler un problème de malocclusion dentaire. Dans ce cas, un traitement d’orthodontie peut être nécessaire. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre dentiste!
Précieuses gencives
Socle et gardiennes de nos dents, les gencives ont une fonction déterminante pour la santé bucco-dentaire. Pourtant, elles ne reçoivent pas toujours les soins attentifs qu’elles mériteraient. Alors essayons aujourd’hui de remettre la gencive au milieu du visage !
Mieux connaître ses gencives
On nomme «parodonte» l’ensemble des tissus qui soutiennent et entourent les dents. Les deux principaux composants du parodonte sont l’os alvéolaire, dans lequel sont ancrées les racines des dents, et la gencive. Cette dernière recouvre et protège l’os, maintient les dents, les préserve, et forme une barrière protectrice autour d’elles. La gencive est constituée d’une couche de sur- face, semblable à de la peau, et d’une couche inférieure de tissu conjonctif riche en vais- seaux sanguins, en nerfs et en fibres de collagène.
Une gencive saine se caractérise par :
- une teinte rosée, avec des nuances individuelles plus claires ou plus foncées. L’aspect est lisse, mais en réalité légère- ment piqueté lorsqu’on l’observe de plus près, tel une «peau d’orange».
- une texture ferme, mais pas dure ni enflée, très légèrement souple lorsqu’on appuie
- l’absence de saignement lors du brossage ou du toucher.
Gingivite et parodontite
Les conditions qui règnent à l’intérieur de la bouche (chaleur, humidité, résidus alimentaires) favorisent la prolifération de micro-organismes en tous genres. En cas de mauvaise hygiène bucco-dentaire, de petites colonies de bactéries parviennent à adhérer à la surface des dents, puis se mélangent à des protéines salivaires, du sucre et des minéraux pour former une pellicule blanchâtre et collante : la plaque dentaire. Si la plaque n’est pas éliminée, elle durcit et se transforme en quelques jours en un dépôt tenace : le tartre. Dans ce sanctuaire aménagé entre les dents et les gencives, les bactéries peuvent se développer à leur guise. Les toxines inflammatoires qu’elles produisent sont la principale cause des gingivites. Il faut bien comprendre ici que la gingivite est une maladie d’origine infectieuse, donc à prendre au sérieux, même si les symptômes initiaux (gencive rouge, enflée, saignant facilement) peuvent parfois sembler anodins, voire passer inaperçus. Car une gingivite non traitée peut se propager au reste des tissus de soutien de la dent, insidieusement et sur plusieurs années, et y causer des lésions souvent irréversibles. On parle dans ce cas de parodontite (ou parodontose), une inflammation profonde susceptible de mettre en péril non seulement l’intégrité des dents (déchaussement, destruction de l’os de la mâchoire, perte des dents, abcès, etc.) mais également d’impacter la santé dans son en- semble.
Facteurs de risque
Des soins bucco-dentaires négligés représentent incontestablement le principal facteur de risque des gingivites et des parodontites. Les autres éléments qui impactent la santé bucco-dentaire sont principalement :
- Le tabac : fumer multiplie par dix (!) le risque de parodontite, en déséquilibrant la flore buccale, en affaiblissant le système immunitaire local et en augmentant la production de tartre.
- Le régime alimentaire : le rôle négatif des sucreries et des sodas n’est plus à rappeler, tout comme celui de l’alcool, qui irrite les tissus de la bouche et interfère avec leur
- Certains médicaments présentent des effets indésirables au niveau de la cavité buccale. Le plus fréquent est la sécheresse buccale, qui rend les gencives plus sensibles aux inflammations et aux infections.
Votre pharmacien ou votre dentiste vous renseigneront plus précisément à ce sujet.
Mieux vaut prévenir que guérir
En toute cohérence avec ce qui précède, la prévention des maladies du parodonte re- pose avant tout sur l’hygiène bucco-dentaire. Celle-ci est contraignante, elle implique une vigilance quotidienne de la plus tendre enfance jusqu’à un âge avancé, raison pour laquelle les «écarts de conduite» ne sont pas rares … et les affections du parodontes classées à la sixième place des maladies les plus fréquentes au monde !
Le brossage des dents doit être effectué après chaque repas. Une technique de brossage correcte est essentielle, tout comme l’usage d’une brosse à dent souple de qua- lité et d’un dentifrice adapté. L’opération doit durer au minimum deux minutes. Mais même la meilleure brosse à dent n’est pas capable d’atteindre toutes les zones à risque, spécialement celles situées entre les dents. Pour cela, après le brossage, l’usage de brossettes ou de fil dentaire s’impose. On terminera avec un bain de bouche pour un effet supplémentaire sur le tonus des gencives et contre la formation de plaque.
En parallèle à l’hygiène quotidienne, un contrôle chez le dentiste et un détartrage annuel, voire plus souvent si nécessaire, est indispensable pour éliminer le tartre qui a malgré tout réussi à s’accumuler. Enfin, il est recommandé privilégier une alimentation équilibrée, pauvre en sucre et en graisses, mais riche en vitamines (spécialement C et D) et minéraux (calcium en premier lieu). Une mastication lente et prolongée favorise la salivation et le nettoyage naturel des dents.
Vitaminez vos gencives !
Vitamine C : essentielle à la production de collagène, qui est le composant principal des tissus de soutien des dents. On se souvient des marins d’autrefois qui partaient plusieurs mois en mer et qui perdaient leur dents à cause du scorbut, une carence en vitamine C, faute de pouvoir manger des produits frais.
Vitamine D : action pro-immunitaire et anti-inflammatoire favorable aux gencives. Indis- pensable à l’absorption du calcium et du phosphore nécessaires à la minéralisation des dents.
Le conseil Pharmacie Populaire : Lactibiane Buccodental
Complément alimentaire à base de ferments lactiques vivants, vitamines C et D. Dès 6 ans. Sucer 1 à 2 comprimés par jour.